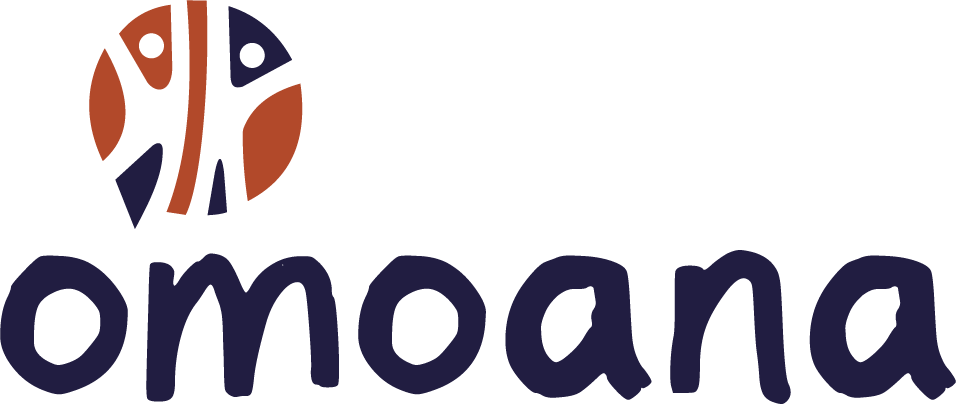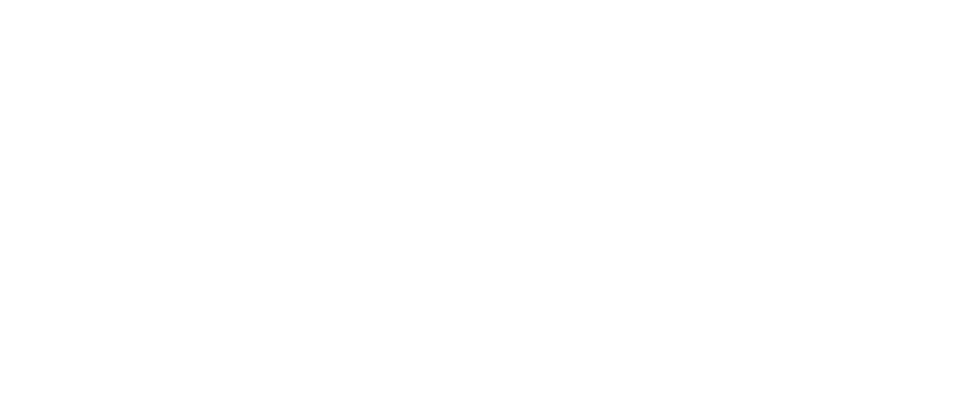Plus de téléphones portables que d’ampoules électriques
Nous connaissons tous ces statistiques insolites et autres classements internationaux qui prêtent souvent à sourire : les Suisses sont les champions de la consommation de chocolat, les Tchèques se distinguent par leur consommation de bière, il y aurait en Finlande plus de saunas en fonction que de voitures en circulation, la France peut se targuer d’être le pays des plus de 300 fromages, etc. Dans ces olympiades des particularités nationales, l’Ouganda n’est pas en reste. En effet, on dénombrerait dans ce pays d’Afrique plus de téléphones portables que d’ampoules électriques !
Tirée d’un article de la journaliste Dara Kerr paru en 2009 (For Uganda’s poor, a cellular connexion, CNet) cette comparaison entre téléphones portables et ampoules, a priori anecdotique, n’est en réalité pas dénuée de tout intérêt. Cette statistique peut même s’avérer riche d’enseignements quant à l’état de développement économique du pays et à ses opportunités futures. Par ailleurs, elle montre que les étapes menant à la diminution de la pauvreté peuvent être innovantes et multiples.
Sous nos latitudes, l’accès à l’électricité n’est pas considéré comme un luxe réservé à quelques privilégiés mais bien comme un service de base, au même titre que l’accès à l’eau courante et potable, à des soins médicaux et à une éducation de qualité. Dès lors, vu d’un pays riche, c’est certainement la faible utilisation d’ampoules qui tend à surprendre en premier lieu ; celle-ci traduisant le manque d’accès à l’énergie électrique. Selon les chiffres de la Banque Mondiale, moins de 20% de la population ougandaise est connectée au réseau électrique. Ainsi, la très grande majorité des ménages cuisine au feu de bois et leurs enfants font leurs devoirs à la lumière de la lampe à huile, autant polluants que nocifs pour la santé. Certainement plus parlant que la simple comparaison des PIB nationaux, cet aspect du développement économique permet de mesurer concrètement l’écart qui sépare notre niveau de vie de celui d’une famille ougandaise moyenne. Outre ce terrible constat, peut-on voir dans notre comparaison initiale entre téléphones portables et ampoules quelques perspectives réjouissantes ? Fort heureusement, la réponse est oui !
Alors que la diffusion de l’énergie électrique tarde, celle de la téléphonie mobile est fulgurante et laisse entrevoir des opportunités, non seulement en Ouganda, mais aussi dans de nombreux pays en voie développement. Rechargés à l’énergie solaire ou à l’aide de batteries de voiture, les téléphones portables offrent pléthore de services par SMS. Dans un contexte où l’accès à l’information est limité, le téléphone fait tout d’abord figure de vecteur idéal de diffusion. Des informations relatives aux prévisions météorologiques, à la propagation des épidémies, à la localisation des centres de soins les plus proches, ou encore aux méthodes agricoles recommandées, deviennent ainsi accessibles aux habitants des régions les plus reculées. En plus d’informer, le téléphone se révèle aussi être une voie d’accès aux services financiers qui font tant défaut dans ces pays. Grâce à des systèmes tels que M-Pesa – littéralement « mobile money » – le téléphone portable devient un compte en banque permettant de payer, d’épargner, ou d’emprunter, le tout à des coûts de transaction réduits. Les téléphones devenant smart et offrant l’accès à internet et à toutes sortes d’applications, il ne fait aucun doute que leur potentiel est encore immense et laisse augurer d’importantes avancées autant pour l’économie, que pour la santé ou l’éducation.
Notons finalement que, aussi surprenant que cela puisse paraître, il semblerait que la téléphonie mobile soit en mesure de contribuer à amener la lumière et l’électricité dans les foyers africains. En effet, un récent article paru dans le Guardian (The Africans buying sunshine with their phones, 2016) rapportait le succès commercial d’un kit d’énergie solaire, comprenant un panneau solaire, une batterie rechargeable, deux ampoules et une lampe de poche LED, ainsi que d’un adaptateur servant à recharger les téléphones. De prime abord inabordable pour de nombreuses familles, ce kit a la particularité d’être vendu à crédit, moyennant des remboursements réguliers (50 centimes par jour)…directement prélevés sur le téléphone portable des acheteurs ! Il se pourrait donc que la vaste utilisation des téléphones portables, couplée à des solutions innovantes, puisse faciliter l’accès à des biens et services de base, tel que l’électricité.
Simon Berset
Trésorier
Soyons du bon côté de l’histoire le 28 février 2016
Contrairement à « mourir de rire » ou « mourir de peur », simples figures de style, « mourir de faim » n’est pas une expression mais une réalité. Dans le monde, un enfant meurt toutes les 5 secondes des suites de la malnutrition et de la faim. Ceux qui en survivent le font au prix de douleurs et de séquelles à long terme.
Outre les nombreuses infections favorisées par un système immunitaire affaibli, la malnutrition a des conséquences à vie sur leurs capacités mentales, cognitives et donc sur leurs perspectives de revenus futurs. Une grande partie des enfants malnutris accueillis à Omoana House ont ainsi été élevés par des personnes qui l’ont eux-mêmes été durant les premières années de leur vie, affectant ainsi leurs capacités mentales, donc leur situation économique et leur sécurité alimentaire, engendrant ainsi un cercle vicieux.
Il serait faux de penser que la faim dans le monde est uniquement un phénomène lointain dû à un manque de ressources des pays du Sud. Cette planète a assez de nourriture pour 10 milliards d’habitants. Comment se fait-il que tant d’enfants agonisent encore de la faim ? Les causes sont multiples. Les plus connues sont la mauvaise gouvernance de certains Etats en proie à la dictature ou victimes de la corruption à large échelle, ainsi que les changements climatiques. Des pratiques axées vers le profit ont également une influence sur la sécurité alimentaire dans le monde. Une partie de la nourriture produite est utilisée pour les agro carburants ou pour nourrir le bétail. L’eau potable, élément indispensable à une nutrition de qualité, n’est pas toujours disponible et parfois privatisée par des géants de l’agroalimentaire. De nombreuses terres des paysans du Sud sont expropriées par des compagnies occidentales, chinoises ou indiennes, pour y implanter des monocultures désastreuses pour l’environnement, au détriment de l’agriculture familiale si nécessaire à une sécurité alimentaire durable. Une pratique ayant ses assises en Suisse joue également un rôle important dans ce désastre. Il s’agit de la spéculation sur les matières premières alimentaires. Des traders basés en Occident achètent des quantités gigantesques de céréales et les revendent à un moment profitable. Ils favorisent la rareté pour que les prix atteignent des montants invraisemblables. Quelle est la conséquence de cette pratique ? Une fluctuation des prix des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux, ce qui a des effets désastreux sur la sécurité alimentaire des familles les plus pauvres. Quelle en est l’utilité? Enrichir des traders à Genève et Zurich, et remplir les caisses des communes, cantons et pays qui accueillent de telles compagnies. Une autre utilité ? Simplement une manière de maintenir un système financier commettant l’un des crimes contre l’humanité le plus crasse pour l’enrichissement de certains. Il est à se demander quand le monde se réveillera. Quand considèrera-t-il la faim dans le monde à sa juste valeur, c’est-à-dire un mal à combattre avec la même vigueur que l’esclavage, la Shoah ou l’apartheid? Cela impliquerait de lutter contre chaque cause de ce phénomène.
En février, le peuple votera sur une initiative visant à interdire la spéculation sur les matières premières alimentaires en Suisse. Elle supprimerait uniquement la spéculation financière motivée par les gains à court terme. En revanche, elle ne toucherait pas au commerce direct et aux transactions sur le marché réel, ni aux couvertures de prix, qui eux permettent la stabilisation du système. Certains craignent qu’elle nuise à l’économie suisse. Quoi qu’il en soit, il serait temps de savoir jusqu’où nous sommes prêts à aller pour notre prospérité. Rappelons que, malgré ce que l’on peut dire, la Suisse n’a pas toujours été du bon côté de l’histoire. Il s’agit aujourd’hui de savoir si elle est prête à défendre des valeurs et avoir une vision à long terme. De plus, certaines entreprises ont déjà compris l’impact funeste de la spéculation financière sur les prix des denrées alimentaires et ont pris leurs responsabilités. Ainsi, le fond de l’AVS ou Raiffeisen se sont retirés de ce marché. Cela contredit donc les dire d’Economie Suisse qui prétend que combattre cette spéculation n’aurait aucun effet positif. Le but d’Omoana est de défendre les droits des enfants d’Ouganda, et c’est dans cette optique que nous vous encourageons à vous renseigner sur l’initiative « Pas de spéculation sur les denrées alimentaires » qui sera soumise au vote le 28 février sur : http://stopspeculation.ch .
Kristin Meyers Bericht
Im Juli 2010 lernte ich bei einem Aufenthalt im St. Moses Childrens Care Centre Adrien Genoud kennen. Ich kam nach einem langen Flug mitten in der Nacht im Kinderheim an und trotz der späten Stunde nahm Adrien mich am Tor in Empfang, nahm mein Gepäck und begleitete mich in meine Hütte – meinem Zuhause für die nächsten Wochen.
Im Laufe der Wochen haben wir viel Zeit miteinander verbracht, vor allem aber lernte ich seine Arbeit und sein grosses Engagement für die Kinder Ugandas kennen. Welch eine Leistung.
Omoana hat es sich zur Aufgabe gemacht, sehr kranke Kinder im eigenen Haus aufzunehmen und sie dort medizinische so zu versorgen, dass sie gesund oder aber mit dem richtigen Umgang mit ihrer Krankheit in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren können. Die Organisation arbeitet eng mit dem St. Frances Hospital zusammen, das direkt nebenan liegt. So ist eine für ugandische Verhältnisse optimale medizinische Versorgung der kleinen Patienten gewährleistet.
Darüber hinaus hat Omoana im Laufe der letzten Jahre eine Landwirtschaftsschule im Norden des Landes, in Gulu, eröffnet. Ein wichtiger Impuls für die Region, denn aufgrund des lang währenden Bürgerkriegs und der immer noch unsicheren Verhältnisse dort ist der gesamte Norden eine vergessene Gegend.
Von meinem ersten Besuch mit Adrien im Omoana Haus ist mir besonders der kleine Kikere im Gedächtnis geblieben. Ein 6 – jähriger Junge, viel zu klein für sein Alter, blind und mit rötlichen Haaren – letzteres geschieht, wenn Kinder über lange Zeit unter Mangelernährung leiden.
Sobald Adrien das Haus betrat, hingen alle Kinder wie Kletten an ihm. Sie zeigten ihm die neuesten Errungenschaften: wie hoch sie springen, wie schnell laufen und wie oft sie sich im Kreis drehen können. Und auch der kleine Kikere fing an, schüchtern zu lächeln, als er Adriens Stimme hörte.
Dann holt Adrien eine Ukulele heraus und fängt an zu spielen: „Ella est là“. Alle tanzen, singen sofort mit und laufen wild um Adrien herum.
Und sogar auf dem Gesicht von Kikere breitet sich ein großes Lachen aus, er klatscht laut in die Hände und sich wiegt sich hin und her.
Kristin Meyer
Schauspielerin
Editorial de « Nouvelles d’Omoana », janvier 2014
Dans une société occidentale en pleine effervescence et prônant un individualisme à outrance, il peut s’avérer parfois difficile de prendre pleinement conscience des inégalités criantes qui régissent notre monde. Pourtant, à l’ère de la communication, en faisant preuve d’un minimum de curiosité et d’intérêt empathique, nous remarquons rapidement à quel point l’équilibre entre le Nord et le Sud est biaisé. Le développement affolant et déconcertant de l’un n’est possible pour l’heure qu’au détriment de l’autre. Et nombre d’entre nous se vautrent dans cette réalité, prétendant qu’un changement n’est pas à notre portée et qu’il dépend de la volonté des acteurs politiques et commerciaux.
C’est oublier alors la force des symboles et de la volonté des peuples. Il ne dépend que de nous de faire en sorte que la globalisation ne soit pas qu’affaire de commerce et d’intérêt personnels. Elle doit également concerner la solidarité et ce choix nous concerne tous.
De nombreux organismes mettent en lumière les absurdités de la politique suisse et internationale qui posent les priorités sur le bien-être économique et l’abondance plutôt que sur la considération des droits de l’homme et le respect de la nature. Les alternatives à ce modèle existent. Par exemple, la qualité et la quantité de notre consommation influencent l’offre et ainsi potentiellement la vie de milliers de fabricants, d’artisans et de producteurs d’ici et d’ailleurs. Le commerce équitable, local ou biologique n’est pas que le fruit d’un effet de mode. L’augmentation de ces produits est le témoin évident qu’une grande part de la population souhaite davantage de respect dans les modes de production. Et si les chartes des nombreux labels qui fleurissent sur le marché méritent encore d’être améliorées, leur apparition est symboliquement extrêmement forte. A nous de ne pas laisser le commerce avide nous manipuler en sélectionnant les magasins, les produits et les labels les plus dignes d’intérêt.
Au-delà de notre mode de consommation, l’aide au développement apporte également une part de réponse pour tenter de rééquilibrer la balance fragile de notre humanité. Elle renforce grandement les populations du Sud et améliore ainsi leur pouvoir de revendication et d’action, ce qui s’avère essentiel pour la défense de leurs droits fondamentaux.
Albert Schweitzer, grand penseur et acteur de l’aide au développement s’il en est, affirmait : « L’idéal est pour nous comme une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint mais il demeure un guide. ». Laissons-nous inspirer par cet idéal et agissons de manière conséquente et réfléchie. N’oublions pas que nous avons le choix ! Il est essentiel de ne pas se reposer sur des acquis et de poursuivre sur ce chemin vers davantage d’équité. Merci à vous, chers donateurs, de soutenir les aspirations, les valeurs et les actions d’Omoana.
Mathilde Jordan
Présidente
Sensibilisation au VIH/Sida
Lorsque des enfants séropositifs et malnutris sont accueillis à Omoana House, la question de la réintégration se pose dès le premier jour. S’ils arrivent dans des états proches de la mort, la raison en est souvent qu’ils ont été laissés à eux-mêmes dans des villages retirés de la région de Jinja. La travailleuse sociale d’Omoana House visitera régulièrement les familles des enfants avant même leur réintégration. Elle devra ensuite évaluer avec ses collègues quel membre de son entourage sera le plus à même de s’en occuper lorsque son état de santé sera stabilisé.
Comme pour chacun de ses projets, Omoana tente d’avoir une approche globale. Ainsi, afin que l’enfant soit reçu comme un individu à part entière, elle mènera des séances de sensibilisation au VIH/Sida au sein de sa communauté. Cela favorisera une réintégration permettant à l’enfant de ne pas être discriminé. Dans les écoles et les communautés où elle se rendra, elle abordera également les moyens de prévenir l’infection, ainsi que l’importance de connaître son statut viral. Grâce à l’équipe de notre partenaire St.Francis HCS, un centre de santé pour personnes vivant avec le VIH, chacun a la possibilité de faire un test, le cas échéant, se soigner et éviter d’infecter d’autres personnes (partenaires, futurs enfants). Cela peut notamment s’avérer utile dans des cas où les propres parents des enfants soutenus n’acceptent pas leur séropositivité. Ils doivent être convaincus de se prendre en main pour ensuite être capable de s’occuper de leurs enfants. Le combat contre le sida n’est pas uniquement une question de soins. C’est avant tout une problématique sociale. L’ignorance peut faire des ravages. C’est pour cela qu’Omoana s’est joint à son partenaire St.Francis HCS et bénéficie de son expertise, afin de permettre à 1’301 personnes dans 19 villages d’avoir accès à de tels services en 2013.
Adrien Genoud
Coordinateur
Santé mentale des personnes touchées par la guerre
Durant plus de 20 ans, le Nord de l’Ouganda a été en proie à une guerre civile entre l’armée de Resistance du Seigneur et les forces gouvernementales. Plus de 25’000 enfants ont été kidnappés pour être utilisés comme soldats. Ils ont été forcés à commettre des atrocités et ont vécu des événements traumatiques qu’ils n’oublieront jamais. Certains ont dû tuer les membres de leur famille, d’autres ont été victimes de violences sexuelles. Dans un état de survie, ils ont parfois dû boire leur propre urine. Vivre de telles expériences à répétition laisse forcément des séquelles à nombre d’entre eux. De retour au village, ils souffrent du syndrome de stress post traumatique, qui peut notamment se manifester par des flashbacks, des insomnies et des troubles de la concentration.
La région a été pacifiée en 2006. Mais selon les études les plus optimistes, 25 % des anciens enfants soldats et 7% de la population générale souffrent encore de ce syndrome, qui, s’il n’est pas traité, ne part pas. Cela affecte leur capacité à gérer une activité génératrice de revenu, et la situation de désespoir dans laquelle ils se trouvent peut les pousser vers l’alcoolisme. Il est important de faire face à ce problème, pour leur bien-être, et pour la réconciliation dans la région. En effet, les personnes souffrant de stress post traumatique sont souvent irritables et peuvent être mal perçues par les autres membres de leur communauté. La santé mentale n’est malheureusement pas dans les priorités du gouvernement. L’Ouganda ne compte que 30 psychiatres pour 34 millions d’habitants.
A partir de 2014, Omoana collaborera avec VIVO, une organisation spécialisée dans le traitement des traumatismes psychologiques dans les pays en guerre. Elle est composée de spécialistes du monde entier et reconnue comme l’une des leaders dans ce domaine. Anett Pfeiffer, psychologue allemande, gère une équipe de thérapeutes ougandais, qui donnent aux populations des thérapies de 12 sessions qui ont prouvé leur efficacité à travers des recherches académiques.
Les fonds sont limités, et l’accès aux endroits les plus reculés est difficile. Les villageois n’ont pas les moyens de se déplacer jusqu’en ville deux fois par semaines pour suivre une thérapie. Omoana permet donc à ses bénéficiaires d’avoir accès aux services de cette organisation.
L’approche globale d’Omoana, cherchant à donner à ses bénéficiaires un soutien économique de qualité ainsi que de faire appel à des spécialistes reconnus de la santé mentale, peut être considérée comme programme de référence dans les régions post-conflit. De plus, Omoana travaille en réseau pour offrir le meilleur à ses bénéficiaires, maximiser les ressources et les connaissances. Mais pour prouver l’efficacité de telles collaborations, ainsi que la corrélation entre les problématiques sociales et économiques en région post-conflit, il est nécessaire qu’un investissement ait lieu au niveau académique. Omoana est ainsi favorable à accueillir des chercheurs dans ce but.
Adrien Genoud
Coordinateur
Le microcrédit, quelques années après
Lorsque nous avons lancé les programmes de microcrédit à Jinja en 2008 puis à Gulu (région post-conflit) en 2010, nous étions convaincus que ce type de programmes, mis en œuvre de manière adéquate, était la clé d’un développement efficace. Au début, bon nombre de bénéficiaires se lançaient dans cette entreprise avec un certain doute. Pourraient-ils rembourser ? Cela allait-il vraiment leur permettre d’augmenter leurs revenus ? Après des formations principalement en entrepreneuriat, données par des agents de crédit motivés, ils ont eu accès à des prêts, initialement d’un maximum de 40.-, atteignant progressivement 250.-. Ils ont ainsi développé leurs activités génératrices de revenus.
Lors de visites récentes de familles touchant des microcrédits, j’ai pu constater que ce concept avait vraiment un impact durable sur leur qualité de vie. Une bénéficiaire exprimait sa joie en disant qu’elle se sentait pousser des ailes ! Il suffit d’observer leurs foyers pour s’en rendre compte. Nombre d’entre eux ont développé leur bétail et témoignent d’une amélioration évidente de leur niveau de vie, que ce soit du point de vue nutritionnel ou de l’accès à l’éducation pour leurs enfants. Ils ont gagné en assurance et ne se considèrent pas comme de simples victimes de la guerre, de la pauvreté ou du sida. 2’320 familles ont reçu des microcrédits en 2013 et de nombreuses autres souhaitent également en bénéficier. Le mérite en revient surtout aux responsables des projets sur place, Achan Immaculate et Anna Sanyu, deux femmes dynamiques et dévouées. Nous continuerons ainsi de développer ces programmes à leurs côtés, afin que notre travail pour assurer la dignité des jeunes Ougandais donne les moyens à ceux qui s’en occupent de le faire de manière indépendante et qu’ils puissent ensuite transmettre leur ailes à leurs enfants !
Adrien Genoud
Coordinateur
Le sida à l’heure de l’adolescence
Mary*, l’une de nos bénéficiaires a maintenant 16 ans. Elle est soutenue par Omoana depuis 9 ans. Orpheline, elle est née avec le sida, et vit avec sa grand-maman, également séropositive. La trithérapie est un traitement à vie pour les personnes atteintes par le VIH/sida. Nos bénéficiaires sont sensibilisés à l’importance d’une prise régulière et constante des cachets, et des potentielles conséquences si cela n’est pas respecté.
Cependant, certains d’entre eux, pour des raisons liées à l’adolescence ou parfois à un certain dégoût de la vie, ne prennent plus leur traitement de manière régulière. Ils développent alors une résistance à la trithérapie ainsi que de nombreuses infections. Mary est passée par cette phase. Elle est maintenant en condition critique, mais reçoit des soins de qualité dans l’une des meilleures cliniques du pays, à Kampala. Elle a un joli visage, ainsi qu’un physique fin et élancé. Les infirmières lui disent qu’une fois rétablie, elle pourrait devenir mannequin. J’y avais déjà pensé, l’imaginant un jour devenir Miss Ouganda ! Mais elle m’a signifié qu’elle préférait devenir médecin ou infirmière, pour aider comme on l’a aidée. Je lui ai alors répondu qu’elle devrait mieux prendre son traitement et surtout être très studieuse à l’école. Elle regarde à nouveau vers l’avenir. Espérons qu’elle pourra reprendre les bancs de l’école en 2014. En attendant, le personnel d’Omoana House recherche et met en place une stratégie pour faire face à cette problématique qui est répandue dans tout le pays.
Adrien Genoud
Coordinateur
* nom fictif